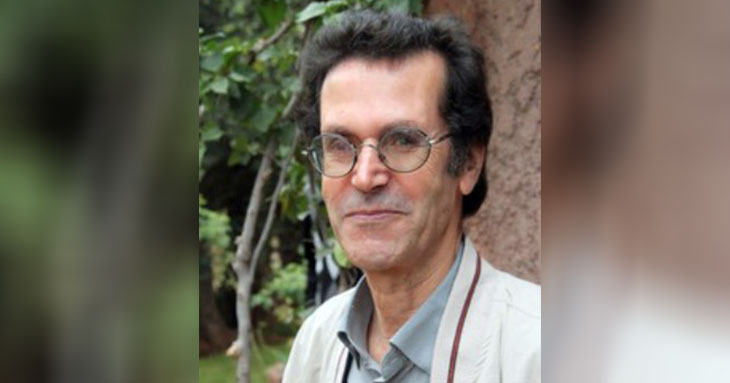Il y a une grande difficulté à tenter de cerner par les mots l’œuvre, ou le travail, ou la pratique de El Khalil El Gherib. L’interroger sur cette question c’est provoquer une réponse nette et paradoxale : « Je ne suis pas un peintre, je ne me considère pas comme un artiste. Ce que je fais c’est de l’ordre métaphysique, existentiel et ludique. Ce n’est pas un travail artistique, il faut se débarrasser de cette conception, comment dire ? Il faut chercher un autre mot. »
Alors, chercher un autre mot pour ce parcours fait de modestie, de solitude et d’ascèse, ou bien faire silence comme le suggérait l’écrivain Edmond Amran El Maleh devant cette œuvre considérable que El Khalil El Gherib ne montre que très rarement, se refuse à signer, à dater ou à vendre mais qui est reconnu aujourd’hui au Maroc et en Europe comme un des plus singuliers dans la création contemporaine.
Chercher un mot pour cette « pratique de vie » qui consiste à ramasser chaque jour dans le périmètre géographique restreint de la ville d’Asilah, sur la côte atlantique au sud de Tanger, des objets abandonnés sur le sol, fils de fer, de cuivre ou de soie, algues ou minuscules cailloux, à le faire avec des gestes qui sont comme des caresses au monde, des gestes qui réactivent, en chacun des objets qu’il « relève », un reste d’intensité qui leur permet de continuer à être, à se transformer encore dans son atelier, cette mesria dans laquelle il va les amasser, les assembler, là aussi où, sur des cartons ou des papiers, il fera naître, à la chaux teintée de nila, des traces promises à l’effacement.
Oui, une pratique qui se confond avec la ville où il vit, emplie de silence, de blancheur, d’attente et de vide, avec la vie même. Comment penser alors son activité à l’aide d’un discours théorique ? Comment tenter de l’inscrire dans le courant dit « de l’art pauvre », de l’utilisation de déchets ?
Certes El Gherib utilise des matériaux pauvres, les recouvre de chaux, ne décide pas de la couleur, la laisse s’introduire d’elle-même par le jeu du temps, de l’oxydation et de l’humidité, par l’effet des moisissures, des décompositions organiques et minérales. Mais cette pauvreté apparente est d’une extrême richesse, celle de la simplicité bien sûr, mais aussi de cette hospitalité qu’il fait au matériau qui peut, grâce à lui, continuer une forme de vie jusque dans la disparition, la pulvérulence, la rouille, le délitement, ou bien la régénérescence lorsque de minuscules insectes s’y développent, lorsqu’un vert violent apparaît sur un cuivre, un jaune d’or à la surface d’un lichen. Une pauvreté revendiquée, El Gherib n’attend rien des richesses matérielles, n’aspire à aucune reconnaissance, ni sociale ni artistique. Son travail doit se comprendre là où se confondent à la fois ce qu’il fait et ce qu’il est, dans cette synesthésie particulière qui se crée entre le geste, sa propre voix, sa façon de regarder le monde, de marcher dans la solitude, de montrer l’absence et l’anéantissement ou de révéler la musicalité de la couleur bleue.
El Khalil El Gherib recherche une réalité intérieure qui n’a rien de contemplatif, rien d’une mise à distance des autres, il se tient aux portes d’un délire créateur dont il se joue sans cesse, évoluant sur ces marges imprécises où il faudrait si peu pour perdre la raison. Une réalité autre, qui ne servirait qu’à révéler sa conscience permanente de la mort, la vanité de toute chose et le passage du temps.
Alors comment dire avec des mots cette relation entre l’intime et l’infini, ce retrait par rapport à son œuvre, cette absence de prouesse dans le faire et ce rejet de toute démarche esthétisante ? Simplement regarder ce qu’il nous montre et faire silence.